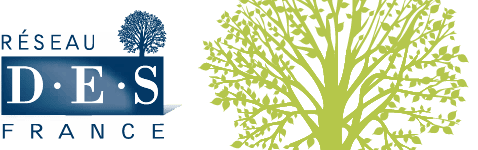Avec la nouvelle victoire de Louis et de sa famille, la justice a fait un pas supplémentaire dans la reconnaissance des dommages causés par le Distilbène®.
En effet, pour la 1ère fois, la cour d’appel de Versailles se prononçait sur un dossier Distilbène® touchant à la 3èmegénération. Elle a reconnu un lien de causalité entre les séquelles de Louis, né prématurément, et le médicament pris par sa grand-mère.
Cependant, les questions juridiques touchent beaucoup d’autres aspects. Afin de mieux les appréhender, nous avons organisé une réunion d’information et de débat autour des thèmes suivants :
- Les procès Distilbène® et les évolutions du droit
- Se lancer dans une procédure juridique : présentation du partenariat Réseau D.E.S. France / FNATH
- Les questions actuelles de société : fonds d’indemnisation, action de groupe (class action)
- La prise en charge du suivi gynécologique des « filles DES » à 100%
- Les licenciements au retour de congé maternité
Pour présenter ces différents aspects et répondre aux questions des participants, étaient présents :
- Arnaud de Broca, secrétaire général de la FNATH, ainsi que Me Karim Felissi, conseiller national de la FNATH,
- plusieurs membres du Conseil d’Administration de Réseau D.E.S. France : Joëlle Berthault Cohen, Claire Sarri, Stéphane Vallégeas. Nous remercions également Emmanuelle Brun pour son aide dans l’organisation de cette réunion.
Les procès Distilbène® et les évolutions du droit (Stéphane Vallégeas)
S’il est aujourd’hui reconnu que le scandale du DES a été à l’origine du renforcement de la pharmacovigilance en France, il est moins évident qu’à travers les procédures juridiques qui se sont succédées depuis 20 ans, « l’affaire du Distilbène » ait été un moteur de l’évolution du droit.
En effet, cette « affaire » présente des aspects très particuliers :
- les dommages provoqués par ce médicament ne touchent pas que la mère qui l’a pris, mais surtout ses enfants, voir ses petits-enfants (préjudice transgénérationnel) ;
- ces dommages ne se révèlent pas dès la naissance mais des années voir des décennies plus tard ;
- ce délai rend les preuves très difficiles à apporter ;
- il faut pouvoir établir un lien de causalité entre les pathologies présentées par les plaignantes et l’exposition au DES ;
- enfin, le fait qu’en France, 2 laboratoires aient distribué le DES sous 2 marques différentes (Distilbène et Stilboestrol-Borne) a longtemps rendu les procédures encore plus complexes.
Malgré ces difficultés, en 1991, deux « filles DES » atteintes d’un cancer Adénocarcinome à Cellules Claires (cancer ACC) du vagin ou du col utérin et disposant des ordonnances (nom du médicament = connaissance du nom du laboratoire) engagent une action judiciaire en responsabilité civile contre le laboratoire UCB Pharma qui a commercialisé en France le diéthylstilboestrol sous l’appellation Distilbène®.
Il est important de noter que ces jeunes femmes et leurs avocates n’ont pas porté plainte dans le cadre d’un procédure pénale. Elles n’ont pas cherché la condamnation du laboratoire mais la reconnaissance de sa responsabilité pour le préjudice subi ainsi qu’une indemnisation.
En septembre 1994, le premier jugement ne tranche pas sur le fond du litige et ne se prononce pas sur la responsabilité du laboratoire UCB Pharma, mais ordonne :
- Une expertise sur le lien pouvant exister entre l’exposition in utero au Distilbène® et le cancer ACC,
- Une expertise médicale pour dresser l’état des connaissances médicales relatives au DES avant la naissance des plaignantes.
Le rapport des experts est terminé en 1999.
Il sert toujours de base aux procédures actuelles, car il démontre :
- qu’à l’époque des prescriptions faites aux mères de ces jeunes femmes, la littérature scientifique aurait du conduire les laboratoires à supprimer les indications de prescription durant les grossesses ;
- que l’exposition in utero constituait un facteur majeur de cancer ACC.
Cependant, pour chaque dossier, il est indispensable que la victime fasse l’objet d’une expertise individuelle, souvent très éprouvante. En effet, la plaignante doit démontrer, d’abord son exposition au DES, ensuite que cette exposition est bien la cause du préjudice.
Le 24 mai 2002, le jugement du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nanterre reconnaît la responsabilité du laboratoire UCB Pharma : « la preuve du rôle causal du Distilbène® auquel…(les requérantes) ont été exposées in utero… est ici rapportée par présomptions graves, précises et concordantes suffisantes ». UCB Pharma fait appel du jugement.
En novembre 2003, la responsabilité d’UCB Pharma est reconnue par le TGI de Nanterre pour deux autres jeunes femmes victimes de cancer, puis en novembre 2004 pour une 5ème jeune femme, qui décédera 2 jours après la plaidoirie.
En février et avril 2004 , la cour d’appel de Versailles confirme les jugements du TGI et retient la responsabilité du laboratoire pour une série de fautes (maintien d’un produit nocif dont l’inefficacité est connue depuis 1953). UCB se pourvoit en cassation.
Le 10 juin 2005, le TGI de Nanterre condamne UCB à indemniser 3 plaignantes atteintes de cancer et, pour la 1ère fois, 5 femmes souffrant de stérilité.
Le 7 mars 2006, la Cour de Cassation met un terme à 15 ans de procédure en rejetant les pourvois d’UCB Pharma. Dans deux arrêts concernant les procédures intentées par deux « filles DES » touchées par un cancer, la haute juridiction confirme les décisions de la Cour d’Appel de Versailles :
- en reconnaissant le lien de causalité entre exposition in utero au DES et cancer ACC.
- en reconnaissant que le laboratoire UCB Pharma avait été fautif en manquant à son « obligation de vigilance ».
Ces 2 points juridiques sont maintenant acquis et bénéficient à toutes les victimes du Distilbène.
Le 10 avril 2009, le TGI de Nanterre reconnaît la responsabilité d’UCB pour 2 enfants de « filles DES » nés prématurément et souffrant de graves séquelles ; il condamne le laboratoire à les indemniser.
Ce jugement est confirmé par la cour d’appel de Versailles le 9 avril 2011 pour Louis, reconnaissant ainsi les conséquences du DES sur la 3ème génération.
Le 24 septembre 2009, la Cour de Cassation a rendu un arrêt important indiquant qu’un cancer ACC, sur la base d’une expertise, est reconnu comme une preuve suffisante de l’exposition in utero au DES. En effet, fait rare en médecine, 60 % des ACC sont en lien avec le DES.
Par ailleurs, la Cour inverse la charge de la preuve au bénéfice des plaignantes : lorsque que la plaignante ne peut prouver quel médicament a été pris par sa mère, il appartient à chacun des deux laboratoires de prouver que son produit n’est pas à l’origine du dommage.
En d’autres termes, la Cour considère que les deux laboratoires constituent, de fait, un groupe, pouvant être poursuivi comme tel (grande nouveauté judiciaire !)
Cependant, le même jour, la Cour de Cassation a rendu un arrêt déboutant une plaignante ayant elle aussi développé un cancer ACC, car les médecins qui l’ont soignée n’avaient pas mis sa pathologie en lien avec une exposition in utero au DES. Aucune expertise n’a été ordonnée pour cette jeune femme. L’absence de lien entre exposition au DES et cancer ACC dans 40 % des cas a, ici, bénéficié aux laboratoires… On mesure là à quel point, même pour des pathologies reconnues habituellement comme étant spécifiques au DES, l’aléa judiciaire est important.
Le 28 janvier 2010, la Cour de Cassation a confirmé son arrêt de septembre 2009 : une plaignante peut assigner solidairement les laboratoires ayant commercialisé le DES, si elle ne connaît pas le nom du médicament qui avait été prescrit à sa mère.
Cependant, la Cour rappelle qu’il appartient à la plaignante d’apporter la preuve de son exposition au DES même si elle ne peut préciser le nom du médicament.
Produire des « documents sources » reste donc essentiel afin que la preuve ne repose pas uniquement sur le rapport d’expertise : ordonnance, extrait de registre de pharmacien, attestation du médecin prescripteur, extrait de dossier médical du suivi de grossesse, attestation circonstanciée de la mère, etc.
Malgré ces avancées, il convient de rappeler que seules les atteintes les plus graves (cancer, stérilité, « petit-enfant DES » handicapé du fait de sa naissance prématurée…) ont abouti à une indemnisation après une procédure souvent très longue (de 5 à 15 ans).
Voici à ce propos le témoignage de Marie :
« Je suis née en 1968 et ma mère a pris du distilbène pendant toute sa grossesse. Nous avons les ordonnances. J’ai connu un parcours qui relève de celui du combattant des hormones : les dysménorhées de mon adolescence, la première hystérographie montrant un utérus typique de l’exposition au DES, les kystes aux ovaires, les opérations, les endométrioses traitées par Enentone. 2 fausses couches, 2 grossesses difficiles (1998 et 2001), pour les 2 j’étais couchée 9 mois strict au lit avec un suivi médical par 3 grands des plus grands Professeurs de France, membres du Conseil Scientifique de Réseau D.E.S. France. Surveillée à la loupe avec des examens tous les 15 jours. Grossesse épanouissante ? Non : du stress, des larmes de douleurs, un corps défait, mais beaucoup de courage et d’espoir d’avoir enfin des enfants.
2 beaux enfants (1 fille et 1 garçon) certes bien portants mais à quel prix ! Puis en 2003 l’endométriose revient en force : douleurs insoutenables et à 33 ans c’est l’hystérectomie totale et annexielle (ovaires et trompes) car dégâts considérables… J’intente un procès avec l’avocat spécialisé dans le DES. Notre dossier est complet et défendable à 100% car j’ai toutes les preuves écrites. Je passe l’expertise. Le résultat, au bout de 5 ans de procédure, avec des changements de cour de justice et de propos souvent très durs à entendre, fut uniquement un dédommagement des frais de justice que j’ai appelé « la sucette du bébé qui pleure ».
Voilà en résumé ce que j’ai vécu. Malgré un dossier « béton et fourni » : pour les experts, je n’avais pas le cancer, j’étais vivante, j’avais 2 enfants normaux, un mari encore là et plus de risque de grossesse car plus d’utérus. Pour eux c’est « la faute à pas de chance » car l’endométriose est venue en plus de mes problèmes….
Mon histoire est à crier de rage car aux yeux des pouvoirs publics, des médecins, leur puissance et leurs compétences sont amoindries par la suprématie des laboratoires et des experts. »
Il convient également de prendre en compte le délai de prescription qui est de 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage, c’est à dire la date à partir de laquelle l’état de la victime est considéré comme stabilisé par un médecin. La détermination de cette date est loin d’être évidente : dans certains cas d’ACC, la date de l’expertise est retenue ; dans d’autres cas, les médecins ont fixé la date à 6 mois après la fin du traitement ; pour les enfants porteurs de handicaps liés à leur prématurité, la date de consolidation est fixée à leur 20ème anniversaire.
Il faut donc être extrêmement vigilant sur cette notion de consolidation avant de se lancer dans une procédure.
Sur l’ensemble de ces sujets, plusieurs personnes se sont plaintes d’avoir été mal informées, d’avoir engagé une procédure (onéreuse) qu’elles ont perdue et sont ainsi doublement victimes du DES…
Notre coopération avec la FNATH, avec qui nous partageons une éthique et des valeurs communes, nous permet d’offrir à nos adhérents une expertise des dossiers afin qu’ils ne se lancent pas dans des procédures vouées à l’échec.
La demande d’une prise en charge à 100% du suivi gynécologique des « filles DES »
Les champs d’intervention de la FNATH sont nombreux… Parmi ceux-ci, le rôle tenu par l’Association au sein du Conseil National de la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie). La FNATH porte ainsi le dossier de cette demande.
Les licenciements au retour de congé maternité
Quelques adhérentes de Réseau D.E.S. France ont fait part de difficultés, allant parfois jusqu’au licenciement, lors de leur reprise du travail à l’issue d’un congé maternité allongé.
Cependant, les témoignages écrits reçus en ce sens sont trop peu nombreux pour envisager de mener une action large, au delà d’une aide apportée au cas par cas par la FNATH.
Aussi, si vous vivez ou avez vécu une telle situation, n’hésitez à pas à nous en faire part en vous rendant sur le site de Réseau D.E.S. France.
Questions / réponses avec la salle
Au sujet de l’expertise…
Me Felissi : c’est l’avocat qui demande qu’une expertise soit menée. Proposer des noms est toujours délicat mais c’est possible ; en revanche, ce qui me semble important c’est d’obtenir du juge qu’une expertise soit menée par des médecins de telle ou telle spécialité médicale ou qu’un collège d’experts soit constitué. C’est d’abord la compétence dans tel ou tel domaine qui importe. A défaut, il est important de se renseigner sur l’expert afin d’essayer de savoir comment il travaille sur les dossiers qui lui sont confiés : fait-il appel à d’autres personnes (appelées des « sapiteurs », c’est à dire des personnes très spécialisées dans un domaine particulier qui jouent alors un rôle « d’expert d’expert ») ou instruit-il les dossiers entièrement seul ?
Par ailleurs, un expert répond aux questions qui lui sont posées par le juge qui le désigne et fixe le contenu et les contours de sa mission. Donc je dirai que le premier travail de l’avocat et de la victime est de présenter une demande d’expertise avec les bonnes questions.
Pour cela, les informations diffusées par Réseau D.E.S . France peuvent vous aider à voir si rien d’important n’a été oublié dans votre demande.
Qui paie les experts ?
Me Felissi : les frais d’expertise sont en principe avancés par le demandeur, c’est-à-dire la victime, c’est donc un point important que l’avocat doit bien travailler en amont. Il faut avoir un dossier suffisamment solide, qui démontre l’insolvabilité de la victime, pour espérer obtenir du juge qu’il fasse supporter la charge de l’expertise en partie à l’auteur du dommage, mais c’est assez rare.
Le coût d’une expertise s’élève à plusieurs milliers d’euros.
N’est-il pas préférable d’aller dans un 1er temps au pénal ?
Me Felissi : non, en général, ça ne fonctionne pas bien. Ainsi, pour peu qu’une responsabilité soit diffuse, après des années de procédures, on n’obtient rien : c’est encore ce qui s’est passé récemment pour l’hormone de croissance… ou pour l’amiante, où les veuves attendent depuis 15 ans qu’un procès soit engagé…
Il faut savoir que le pénal impose une interprétation extrêmement stricte des textes : si on ne rentre pas exactement dans les cases existantes, les chances d’obtenir une condamnation sont infimes… Or, le droit pénal actuel n’a pas été conçu pour les spécificités de la délinquance industrielle sanitaire…
Si l’on ajoute à cela que le pôle de santé publique dispose de très peu de moyens…
Au civil au moins, les dossiers du DES ont davantage de chances d’aboutir, s’il n’y a pas prescription. Donc pour répondre à votre question, je dis qu’il faut être prudent avec le pénal.
Qu’est ce qu’est la consolidation, et la date de consolidation ?
Me Felissi : C’est une notion qui est très bien adaptée aux accidents : après avoir eu un accident, avoir été soigné, il arrive un moment où les médecins ne peuvent faire plus pour que vous récupériez votre état de santé antérieur. C’est ce qui détermine une date à partir de laquelle les soucis de santé que vous avez encore se réduisent à des séquelles et à des soins d’entretien, pour éviter une aggravation par exemple.
Mais on utilise cette notion également pour des maladies, et cela devient beaucoup plus compliqué : par exemple, dans des dossiers de cancers : que va-t-on consolider, et quand ? Il peut y avoir des séquelles, les personnes continuent d’être suivies, la victime peut être en rémission, etc…
C’est donc une notion qui se marie mal avec certaines situations… lorsque par exemple, c’est après qu’une femme ait fait plusieurs fausses-couches qu’on s’aperçoit que le DES est en cause…
Or la date de consolidation détermine le point de départ de la période pendant laquelle on peut demander réparation d’un préjudice. Depuis la réforme, le délai de prescription a été ramené à 10 ans (au lieu de 30 auparavant). Cela signifie que 10 ans après la consolidation, on n’a plus aucun droit à indemnisation, quel que soit le préjudice subi.
La date de consolidation se travaille également à l’expertise. C’est l’un des rôles du médecin-recours de rester vigilant sur la date de consolidation pour qu’un dossier aussi fourni soit-il ne soit débouté pour raison de prescription. Il n’y a pas de recette, de règle établie. C’est un vrai travail, au cas par cas.
Dans les cas de cancers, à partir de quand détermine-t-on la date de consolidation ?
Me Felissi : cela dépend du type de cancer, cela se joue vraiment à l’expertise, et encore une fois, cela se travaille en amont avec votre médecin-recours, suivant les pièces que vous apportez.
Il peut arriver que l’expert judiciaire refuse de fixer une date de consolidation, s’il ne peut pas s’appuyer sur des connaissances scientifiques suffisantes par exemple, alors le plus souvent, le juge décide de fixer la date de consolidation à la date de l’expertise.
Cela été le cas souvent dans le domaine du DES, et aussi dans d’autres domaines, mais pas toujours. Ainsi, nous avons été informé d’un dossier d’une jeune femme atteinte d’un cancer, pour laquelle la date de consolidation a été fixée à 6 mois après la date des soins, ce qui entraîne de fait la prescription de son action en justice…
Cet exemple montre bien que ce n’est jamais gagné par avance, que ce n’est pas parce qu’une personne a gagné avec un dossier similaire au vôtre que vous-même allez gagner…
En premier lieu, dans un dossier comme celui-là, lorsqu’on reçoit le pré-rapport d’expertise, il faut réagir en déposant un « dire » et argumenter, en s’appuyant sur la littérature scientifique, pour faire changer la situation et modifier la date de consolidation. L’expert est tenu de répondre par écrit à un « dire ». Si malgré tout le dossier d’expertise est déposé, il faut argumenter pour obtenir une contre-expertise au cours de laquelle l’on tâchera d’obtenir une autre date de consolidation, toujours en apportant des données scientifiques.
Qu’est-ce qu’un médecin-recours ? Comment le choisir ?
Me Felissi : un médecin-recours est spécialement formé à la discipline du dommage corporel (diplôme de Réparation juridique du Dommage Corporel), et il vous accompagne. Il y a plusieurs façons de le choisir : votre généraliste ou le spécialiste qui vous suit peut en connaître un ; il existe également une association nationale des médecins-recours, que l’on peut contacter. ( http://www.anmcr.asso.fr/ )
Le premier contact que vous établirez est important ; il doit vous expliquer la manière dont il travaille, les dossiers qu’il accepte, comment cela va se passer…
On peut voir aussi dans quelle mesure il connaît le sujet, l’histoire du DES, les conséquences, mais ce n’est pas forcément le plus important, il vaut mieux choisir un médecin-recours qui à l’habitude des dossiers complexes et dont vous sentez qu’il souhaite travailler avec vous.
L’inconvénient du médecin-recours est qu’il est à votre charge, et ses honoraires peuvent être assez élevés (jusqu’à 2000 €), mais dans des dossiers comme le DES, son rôle est véritablement déterminant.
Le médecin-recours vous accompagne à l’expertise. Il l’a préparée et travaillé en amont avec vous et il est votre conseiller médical lors de l’expertise.
Les questions les plus importantes, dans les dossiers DES, sont de 3 ordres :
- – démontrer l’exposition au DES
- – démontrer que le préjudice est bien lié au DES
- – mettre en avant les bons arguments pour que les préjudices soient chiffrés au plus juste de votre situation
C’est le rôle du médecin-recours de donner au juge des éléments qui permettent de poser les bonnes questions…
Le médecin-recours et le médecin expert ne sont pas les mêmes ?
Me Felissi : Non, le médecin-recours c’est vous qui le choisissez et il vous accompagne et vous assiste. L’expert judiciaire est un médecin expert, qui, lui, est désigné par le tribunal.
On peut grossièrement dire que l’expert judiciaire va instruire votre dossier, à charge et à décharge, sur le plan médical et va répondre aux questions qui lui sont posées. Le laboratoire va venir avec son propre médecin-conseil, lequel va chercher à démontrer, par exemple, que votre dommage ne trouve pas sa cause dans l’exposition au DES. Si en face, aucun médecin n’est là pour contre-argumenter, les arguments techniques, médicaux et scientifiques du médecin employé par le laboratoire peuvent passer… Certes, l’expert judiciaire est là mais c’est fondamental, à ce stade, d’apporter la contradiction …
Votre médecin-recours vient vous défendre sur le plan médical, pendant l’expertise, en s’appuyant sur son avoir-faire, sur la littérature scientifique. Il ne faut pas vous retrouver tout seul devant les médecins conseils des laboratoires lors de l’expertise…
Autrement dit, c’est expert contre expert…
Me Felissi : Oui, on peut caricaturer mais vraiment, on ne fait pas d’économies sur le médecin-recours ; il est une pièce essentielle.
Est-ce qu’un lien de causalité a été établi par les tribunaux entre DES et grossesses extra-utérine (GEU) à répétition ?
Me Felissi : Les GEU sont des indices d’exposition au DES, cela fait partie des éléments pris en compte, mais vraiment on ne peut pas dire oui ou non sans avoir étudié un dossier.
Pour ma part, je n’ai pas vu de reconnaissance sur ce seul point-là, mais plutôt sur des malformations vraiment prononcées et très typiques du DES.
Mais, quand on a les ordonnances, on n’a plus besoin de ce faisceau d’indices ?
Stéphane Vallégeas : le problème c’est que le juge va se demander si une ou deux GEU provoquent un préjudice suffisamment important pour justifier une indemnisation… C’est à dire, quel est le préjudice ? Dans des procès auxquels j’ai assisté, des femmes ont eu des malformations et, en plus, ont eu des GEU : cela à fait partie des éléments pris en compte dans le dossier, mais n’a pas fait l’objet d’un jugement spécifique.
Me Felissi : il n’y a pas une jurisprudence bien établie.
Alors même que cela empêche d’avoir des enfants naturellement, que cela oblige à passer par les FIV, que c’est lourd… ?
Me Felissi : c’est un préjudice. Mais encore une fois, il va falloir démontrer l’exposition, puis le lien de causalité avec le préjudice. Le fait de ne pas pouvoir avoir d’enfant est un préjudice reconnu. Cela s’appelle le préjudice d’établissement, c’est à dire l’impossibilité de créer une famille. Mais, il faut savoir qu’en France, ce préjudice n’est pas indemnisé de manière importante, sauf lorsque les dommages sont extrêmement importants… L’exemple typique est dans l’arrêt concernant Louis, « petit fils DES » handicapé à 80 % du fait de sa prématurité : le préjudice d’établissement a été établi à 50 000 € et on peut constater que le TGI avait été plus généreux que la cour d’appel.
Mais il ne faut pas penser que le montant que vous obtiendrez sera un indice de reconnaissance de votre souffrance…
En réalité chaque cour d’appel a son propre barème secret. Ainsi, on sait que certaines Cour d’appel sont moins généreuses que d’autres.
Vous-même, jusqu’où allez-vous dans l’accompagnement des personnes ?
Me Felissi : Moi, je vais avec les victimes à l’expertise mais dans la dynamique d’un travail d’équipe avec le médecin-recours et la victime.
Cela dit, je conçois mon travail comme étant un conseil indépendant : même si c’est pénible de le dire, lorsque je pense que le dossier n’est pas suffisamment étayé je dis à mon client : « n’y allez pas, ne vous lancez pas dans une procédure judiciaire. ». J’ai des victimes qui m’ont quittées parce qu’on n’était pas d’accord…
Concernant les pathologies caractéristiques du DES, comme l’utérus en T ? Peut-on penser que cette malformation soit reconnue comme une preuve ?
Me Felissi : Je m’avance un peu, car ce n’est pas automatique, mais quand on compare les arrêts de cour d’appel, il est semble bien que certaines malformations typiques sont reconnues plus facilement comme preuve de l’exposition… c’est un peu comme avec l’amiante : certaines pathologies (mésothéliome) sont typiques d’une exposition.
On met en parallèle deux types d’éléments : d’un côté la malformation, d’un autre côté, les études scientifiques : quand les deux vont dans le même sens, c’est un indice assez fort pour établir une preuve d’exposition et un lien de causalité.
La difficulté c’est quand la littérature scientifique est peu abondante car il sera plus difficile de convaincre le juge…
Les études scientifiques jouent un rôle très important pour convaincre le juge.
Stéphane Vallégeas : lorsqu’on voit que certains dossiers de cancer ACC ont été déboutés, on ne peut qu’être prudents…
Moi je n’ai pas les ordonnances, mais ma fille a un certificat médical établi par le Pr Tournaire, où il est écrit clairement que l’utérus en T de ma fille est du au DES.
Stéphane Vallégeas : un point important : le Pr Tournaire fait partie de l’association, il a un rôle important membre du Conseil Scientifique et de ce fait il est attaqué par les avocats d’UCB et de l’assureur qui remettent en cause son impartialité… Ceci pour vous dire que ce n’est pas forcément suffisant d’avoir un avis médical sans preuve.
Me Felissi : Vous devez être conscient qu’en face de vous il y a des gens qui ont énormément de moyens pour dire que vous ne devez pas être indemnisée… Pour eux, tout argument sera bon : ils recherchent le grain de sable qui va faire capoter le dossier.
Ne croyez pas que je sois pessimiste : oui, il faut se lancer, se battre, mais c’est un vrai travail, ce n’est jamais gagné d’avance : il ne faut pas croire au miroir aux alouettes.
Laetitia : Il faut bien comprendre qu’au delà du fait de rassembler des pièces, se lancer dans une procédure, c’est être face à quelqu’un de très puissant, même lorsqu’on pense être dans son bon droit. En tant que victime, c’est une situation très éprouvante pour laquelle il faut être entourée, car ce n’est pas le rôle de votre avocat de vous soutenir psychologiquement. A force d’entendre les arguments de la partie adverse, on finit par douter de soi.
Me Felissi : il faut faire une grande différence entre ce que vous avez vécu, la réalité de votre histoire et la réalité judiciaire.
Il y a votre vie d’un côté, et il y a ce temps judiciaire de l’autre : ce ne sont pas les mêmes réalités, et c’est le rôle de votre avocat de vous l’expliquer. Votre avocat doit prendre un temps avec vous pour que le combat judiciaire ne vous détruise pas.
Les laboratoires sont-ils condamnés solidairement ? Les assureurs se retournent-ils contre eux ? Et si un laboratoire est mis en liquidation judiciaire ?
Me Felissi : Les laboratoires appellent leur assureurs à la procédure pour que la décision leur soit opposable.
Compte tenu de la jurisprudence de 2009, quand on a un doute sur le nom des laboratoires, il faut assigner les deux. Dès lors qu’on n’a pas de doute sur le nom du médicament, on n’assigne que le laboratoire concerné.
Enfin, les laboratoires se portent bien… et il y a peu de risque qu’ils fassent faillite…
Vous ne nous avez parlé que d’action individuelle : en France aucune procédure collective n’est possible ?
Me Felissi : Non, pas à ce jour. En revanche, à la FNATH, chaque fois que nous avons été auditionnés sur le Mediator, à l’Assemblée Nationale, nous avons développé une notion un peu technique, mais qui a été reprise dans le rapport de conclusion des travaux de la mission parlementaire(1)
. Ce sera très long d’obtenir cela, mais l’idée est d’obtenir, pour les accidents médicamenteux, que la notion d’implication soit privilégiée par rapport à la notion de causalité : au lieu de prouver la relation de cause à effet, dès lors que le produit est impliqué, la causalité ne serait plus à rechercher. C’est en fait l’idée de la loi Batinter, qui a créé un régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Auparavant, dès lors que plusieurs véhicules étaient impliqués dans un accident, la victime était dans l’impossibilité de définir qui avait causé son dommage. Depuis la loi Batinter, à partir du moment où un véhicule est impliqué, sa responsabilité est engagée : avec l’obligation d’être assuré, on sait que le propriétaire sera solvable. Ensuite, les assureurs règlent leurs comptes entre eux. L’idée est d’obtenir l’équivalent en matière de santé publique…
Laetitia : c’est bien déjà que cette idée ait été reprise dans le rapport final…
Me Felissi : d’autre part, une loi sur le médicament est en préparation, le conseil de la CNAM va donner son avis en juillet, puis elle sera présentée au parlement. A la FNATH, on a terminé de travailler sur un texte et on a rédigé une proposition de loi qui reprend celle présentée au parlement, il y a quelques années, sur la class action (l’action collective) pour l’appliquer aux médicaments.
Stéphane Vallégeas : La FNATH est très engagée dans la santé publique, dont le DES, pour faire évoluer la loi. Elle intervient également au sein de la CNAM.
(1) Rapport d’information n° 3552, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juin 2011, en conclusion des travaux de la mission sur le Mediator et la pharmacovigilance, pages 99 et 100. Téléchargeable sur internet :http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3552.asp